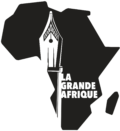Le 10 mai dernier, Pretoria a de nouveau saisi la Cour internationale de justice (CIJ) “pour mettre fin à l’opération militaire israélienne à Gaza” qu’il estime aggraver le “génocide” déjà en cours sur place. Cette plainte sud-africaine intervient quelques jours seulement après l’organisation de “la première conférence mondiale anti-apartheid pour la Palestine” à Johannesburg, invitant à l’occasion « des intellectuels et politiques du monde entier”. Bon nombre d’entre nous peuvent être amenés à se demander pourquoi la nation arc-en-ciel se saisit autant du dossier palestinien. Quelle singularité caractérise l’Afrique du Sud par rapport au reste du monde à ce sujet ? Cet article présente l’apartheid comme étant le référentiel qui connecte les trajectoires de l’Afrique du Sud et de la Palestine d’une manière si particulière.
L'Afrique du Sud sous apartheid: un régime intimement lié à Israël
Ce qui distingue foncièrement la nation arc-en-ciel des “autres nations qui ont payé les frais du colonialisme”, c’est le système d’apartheid qui a cimenté son destin au cours du demi-siècle dernier, accordant à la minorité blanche des droits et privilèges inaccessibles aux autres ; et surtout à la majorité noire. L’apartheid est ici entendu comme un “système d’oppression et de domination d’un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires”. Il a été institutionnalisé dans la constitution de 1948, date symbolique où “à la fois l’Afrique du Sud sous apartheid et Israël sont nés”. Loin de constituer des réalités distinctes, ces deux entités se sont entraidées, car oui, “Israël a soutenu le régime d’apartheid sud-africain sur le plan économique, politique et militaire”. Sous l’ancien régime, “l’Afrique du Sud était l’un des premiers États à reconnaître Israël” tandis qu’en 1953, “son premier ministre Daniel François Malan, était le premier chef de gouvernement étranger à le visiter”. Cette relation peut aussi être décortiquée sous l’angle religieux puisqu’à l’époque, au moins une partie des Afrikaners (blancs sud-africains) “voit Israël comme une autre petite nation, entourée par des ennemis”, pour laquelle “la Bible” est perçue comme un élément “vital” pour sa survie et qu’il faudrait donc soutenir en tant que “Nation du Livre” . De l’aveu même du Premier ministre John Vorster en 1971, le pouvoir sioniste est un allié particulier pour le régime raciste sud-africain : “Nous voyons la position et les problèmes d’Israël avec compréhension et sympathie. Comme nous, ils doivent faire face à une infiltration terroriste à la frontière, et comme nous, ils ont des ennemis déterminés à les détruire”. Pire encore, Israël était considéré en 1986 comme “la seule nation démocratique […] qui s’est abstenue de la majorité des sanctions que la communauté internationale a infligé au régime d’apartheid sud-africain ».
La convergence des deux résistances
L’apartheid n’a été aboli en Afrique du Sud qu’après d’intenses mobilisations (marches, boycotts etc) engagées principalement par la communauté noire du pays, et ce, pendant plus de quarante ans. Bien que ce volet semble sous-documenté, les Palestiniens ont bel et bien répondu présent à leurs côtés, bien qu’ils vivaient également en parallèle sous le joug de l’injustice. Ce rapprochement entre les luttes des Palestiniens et des Sud-africains noirs s’est notamment articulé autour de deux figures emblématiques, à savoir Nelson Mandela et Yasser Arafat. A la fin des années 1970, le leader de l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine) n’hésita pas à entreprendre une visite en Afrique du Sud alors sous apartheid, marquant son soutien à son homologue sud-africain et posant à l’occasion l’un des premiers jalons de cette grande amitié qui, au-delà des deux individus, symbolise une fraternisation progressive des liens entre la résistance palestinienne et Sud-africaine. Un rapprochement puissant qui explique que “les principaux acteurs noirs sud-africains ont toujours considéré la lutte pour la liberté et l’auto-détermination comme étant la même que celle des Palestiniens après que Nelson Mandela fut libéré de prison” en 1990. Nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens” : le premier président d’Afrique du Sud post-apartheid ne pouvait mieux faire pour graver dans le marbre l’attachement grandissant de Pretoria à la libération de la Palestine et transmettre cet engagement aux générations suivantes. Preuve en est, son arrière-petit-fils Mayibuye Melisizwe Mandela a lui-même a rappelé l’appui des Palestiniens à la cause que défendait son peuple sous oppression : ils “ont apporté soutien et inspiration à notre mouvement anti-apartheid, offrant un précieux appui moral et politique. Leur engagement indéfectible pour la justice a résonné en nous et a encouragé nos efforts pour mettre un terme à l’apartheid”.
Une Afrique du Sud post-apartheid qui retient les leçons de son passé.
Bien que Pretoria soit de loin le premier partenaire économique de Tel Aviv sur le continent africain, la nation arc-en-ciel n’oublie guère son douloureux héritage. L’ANC (African National Congress) ayant combattu l’ancien régime d’apartheid, ami d’Israël, et étant le parti au pouvoir depuis la première élection libre de 1991, le soutien politique à la cause palestinienne s’est assez naturellement maintenu au sommet de l’Etat jusqu’à ce jour, malgré une période de refroidissement avec son allié arabe entre temps. Le fait que l’Afrique du Sud dispose de la plus grande communauté juive d’Afrique avec près de 51 000 ressortissants n’y change rien non plus. Il n’y a aucun amalgame à faire à ce niveau-là et Pretoria l’a bien compris : la dérive israélienne qu’elle dénonce est une chose, la communauté juive sud-africaine et le judaïsme en sont une autre.
Les Palestiniens ne cessent de subir injustice, répression et massacres. Le système d’apartheid israélien, finalement reconnu par Human Rights Watch (2021) et Amnesty International (2022), a pour particularité de s’étendre au-delà du territoire que l’ONU reconnaît à Israël. Tel Aviv ne cessant de contrôler et de coloniser toujours plus de terres palestiniennes, son arsenal (législatif, politique et militaire) répressif contre la population indigène s’y étend simultanément. En d’autres termes, au-delà des Arabes israéliens, un Palestinien vivant en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est n’échappe aucunement à la politique d’apartheid d’Israël, alors même qu’il se trouve en territoire palestinien sous le droit international. Cela, car dans les faits, le régime sioniste contrôle toute la zone disputée, allant même jusqu’au plateau du Golan qui pourtant appartient de jure à la Syrie.
Poursuivre Israël sur le terrain politico-judiciaire revêt (au-delà des motifs invoqués) une portée tout à fait symbolique pour l’Afrique du Sud au regard de l’antécédent historique liant Tel Aviv au régime d’apartheid sud-africain. Portée par l’élan de résistance à l’apartheid propre à son histoire, l’Afrique du Sud se distingue du reste de la communauté internationale en contexte actuel. Dans une discussion ministérielle, la ministre des Relations internationales, Naledi Pandor, ne laissa aucun doute à ce sujet : “ceux d’entre nous qui sont libérés de l’apartheid ne peuvent jamais consentir à une quelconque forme d’oppression qui y soit lié. Nous ne pouvons tolérer cela”. En janvier dernier, Pretoria a donc saisi la CIJ afin de traduire Israël en justice pour “actes génocidaires”. À La Haye, la déclaration de son ambassadeur aux Pays-Bas, Vusimuzi Madonsela, avait de quoi faire trembler les murs : “en tant que Sud-Africains, nous sentons, voyons, entendons et ressentons au plus profond de nous-mêmes les politiques et pratiques discriminatoires inhumaines du régime israélien comme une forme encore plus extrême de l’apartheid institutionnalisé contre les Noirs dans mon pays”. Des mesures provisoires seront finalement émises par les juges, donnant raison à Pretoria et envoyant un signal fort aux pays non-occidentaux, qui pour beaucoup voient dans la justice internationale une logique “non pas universelle mais hémisphérique” reposant sur un deux-poids deux-mesures favorisant l’Occident. Le 16 mai dernier, la CIJ a tenu des auditons publiques pour la seconde fois, après que la délégation sud-africaine l’a sollicité, affirmant cette fois qu’Israël commet un “génocide”, en massacrant au moins 35 000 Palestiniens dans une bande de Gaza qu’il réduit à un champ de ruine. Il est aussi pertinent de rappeler que l’Afrique du Sud a activement participé avec l’Algérie à la tentative d’éviction d’Israël du sommet de l’Union africaine (UA) en 2023. Chose désormais actée depuis février dernier, l’UA ayant “définitivement mis au ban” Tel Aviv au regard des événements susmentionnés.
Poursuivre cette réflexion est impératif. Mais au lieu de seulement se demander pourquoi l’Afrique du Sud défend autant la cause palestinienne, ne faudrait-il pas questionner les mécanismes à l’œuvre ayant jusqu’ici mené le reste de la communauté internationale à soutenir si fébrilement la Palestine dans sa quête indéfectible de liberté et d’indépendance ?