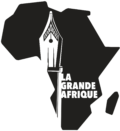Comme décrit dans le précédent volet, la pollution et le changement climatique font de l’eau un adversaire redoutable. Mais en dépit de leur ampleur spectaculaire, ces défis ne constituent qu’une face du dilemme de l’or bleu en Afrique. Et pour cause, entre absence de moyens, sabotages et rivalités étatiques, l’accès à l’eau fait également face à par l’épreuve de l’infrastructure.
I – Equipements hydrauliques : L’Afrique centrale en proie à un inquiétant déficit
Si le manque (de maintien) d’infrastructures hydrauliques n’est pas l’apanage de l’Afrique centrale, celle-ci reste particulièrement touchée sur le continent. Brazzaville au Congo, en est un exemple parlant. Dans une conférence de presse tenue en septembre dernier, Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement a admis que dans le pays, “chaque jour, 95 millions de litres d’eau sont produits. Malheureusement, en raison de la mauvaise qualité des réseaux de distribution, plus de la moitié de cette production est perdue […] Si c’est un tuyau percé, l’eau sort à moitié. Si c’est un tuyau dont l’eau est de mauvaise qualité, au bout de la chaîne, le consommateur ne la consomme pas“. Finalement, l’eau, dont le pays est abondamment doté, se transforme pour le citoyen en un véritable luxe, car celle qui lui parvient est en moindre quantité et dans bien des cas de mauvaise qualité. Pas étonnant, donc, de constater le positionnement du Congo-Brazzaville et de l’Afrique centrale dans un récent sondage de l’Afrobarometer couvrant 39 pays. Au sujet du manque d’eau potable pour les besoins domestiques, les trois pays les moins bien classés se situent tous en Afrique centrale : le Gabon (42% des répondants disent en avoir manqué plusieurs fois voire toujours en 12 mois), le Congo-Brazzaville (41%) et le Cameroun (40%). Interrogés sur la performance de leur gouvernement dans les services d’eau et d’assainissement, les Gabonais sont les moins satisfaits de tous (13% d’approbation), suivis à une place près des Congolais de Brazzaville (15%). A cela s’ajoute un rapport de la Facilité africaine de l’eau, rendant compte du “financement total du secteur de l’eau en Afrique par région”, qui place l’Afrique centrale au tout dernier rang. Les fonds émanant d’Afrique centrale, principalement des gouvernements, ne pèseraient que 5% dans le financement total déployé pour l’eau en Afrique, bien derrière l’Afrique de l’Ouest (18%), l’Afrique de l’Est (20%) ou encore l’Afrique du Nord et l’Afrique australe, tous deux comptant respectivement pour 28% du total.
II - Insécurité : L’eau, un terrain également miné par les groupes terroristes au Sahel
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Trois pays disposant de potentiels d’eau considérables dans leurs sous-sols. Mais tant de contextes où l’accès à l’eau recule en raison de la menace terroriste. Pour y voir plus clair, prenons le cas de Djibo, au nord du Burkina Faso. Cette ville d’une soixantaine de milliers d’habitants a subi ces dernières années de multiples sabotages, au niveau de certaines pompes et forages. En 2022, plus de 30 installations ont été ciblées. En 2024, la situation ne s’est guère améliorée à en croire Fatmata Bance. La secrétaire permanente des ONG au Burkina Faso estime que les enjeux hydriques restent toujours “exacerbés par la situation sécuritaire du pays, où actuellement il y a les forces terroristes qui dans certaines régions détruisent les infrastructures d’eau, [d’]hygiène [et d’]assainissement ». Ouagadougou n’est qu’un reflet de ce qui semble être une fièvre sahélienne : “avec l’augmentation des attaques terroristes principalement au Mali, au Niger et au Burkina Faso mais atteignant les pays côtiers comme la Côte d’Ivoire, le Togo et le Bénin, de nombreux villages ont été abandonnés ou sont sous le contrôle de groupes armés […]. Les populations déplacées sont privées de leurs sources traditionnelles d’eau, qu’il s’agisse de cours d’eau naturels, de bornes-fontaines ou de forages, ce qui coupe leur approvisionnement en eau et donc l’accès à leurs moyens de subsistance”. D’après un élu malien, ces nouveaux hommes forts “fixent la loi pour la gestion et l’utilisation de l’eau et d’autres ressources naturelles en délimitant les zones à exploiter”. Au Niger voisin, un projet entre l’Union européenne et le Partenariat Mondial de l’Eau au bassin de la Mékrou, n’a par exemple pas pu être lancé “comme planifié en août 2020 en raison d’une attaque terroriste dans laquelle huit personnes ont été tuées”. Selon un expert du Comité permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, la région est marquée par une véritable “compétition entre les terroristes et les populations”. Entre les civils qui collectent et acheminent l’eau, et “les bandes armées qui occupent les contrées rurales [et qui] sont sur les points d’accès à l’eau”. Ainsi, au Sahel, nombreux sont les projets hydrauliques qui faillissent à l’épreuve sécuritaire, caractérisée par une menace terroriste mettant à mal les infrastructures de l’eau et l’avenir des populations.
III - Rivalité régionale : Le grand barrage de la renaissance ou la pharaonique privatisation d’une eau transfrontalière ?
Contrairement aux apparences, le développement d’infrastructures hydrauliques n’est pas toujours synonyme de bonne nouvelle pour tous. C’est autrement plus vrai quand ces dernières embrasent les différends inter-étatiques. Le Nil, la plus grande rivière au monde, est peu à peu devenue le terrain de bataille entre l’Ethiopie, point de départ du Nil Bleu, le Soudan et l’Egypte en aval, en raison du très contesté méga barrage de la Renaissance (GERD). Ce gigantesque ouvrage, le plus grand d’Afrique, lancé en 2011 et opérationnel depuis 2022, reflète les ambitions stratosphériques d’Addis-Abeba. Deuxième puissance démographique d’Afrique, l’Ethiopie voit en ce barrage hydroélectrique une opportunité unique de consolider son développement économique et faire chuter son niveau d’extrême pauvreté en doublant sa production d’électricité [alors que la moitié des Ethiopiens n’y a pas accès], cela tout en constituant “l’un des rares facteurs d’unité nationale”. Toutefois, ce à quoi Addis-Abeba semble faire la sourde oreille n’est autre que le risque réel de priver d’eau ses voisins Soudanais et surtout Égyptiens. Avec plus de 100 millions d’habitants, l’Egypte constitue la troisième population du continent et le pays arabe le plus peuplé au monde. Près de 95% des Egyptiens vivent aux abords du Nil, cours d’eau dont le pays dépend à 97% pour couvrir ses besoins hydriques. Des chiffres aussi impressionnants qu’évocateurs de la menace existentielle que représente le projet éthiopien pour l’avenir de la première puissance économique d’Afrique. Depuis 2015, au moins quatre tentatives de négociations en vue d’un accord tripartite ont eu lieu entre Le Caire, Khartoum et Addis-Abeba, mais aucune ne semble avoir abouti. Avec le temps, l’Egypte se retrouve davantage isolée, car le Soudan est non seulement enlisé dans une guerre civile depuis 2023, mais en plus de cela, le général putschiste au pouvoir, Abdel Fattah Al-Burhane, a déclaré cette même année être “d’accord sur tous les points” concernant le GERD à la venue du premier ministre éthiopien à Khartoum. Loin d’une coopération régionale apaisée comme celle entre les huit pays traversés par le fleuve du Zambèze, l’évolution du dossier du Nil laisse craindre le surgissement immédiat d’une véritable guerre de l’eau entre deux géants du continent.