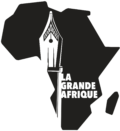Alors qu’il est souvent critiqué comme un outil de domination de la France, le franc CFA (FCFA) est encore aujourd’hui la monnaie de beaucoup de ses anciennes colonies. Cet article propose d’aller au-delà des questions symboliques et de montrer que le FCFA s’inscrit dans une stratégie monétaire qui peut, bien sûr, faire l’objet de débat mais qui a une cohérence économique pour ces États.
Du « franc des colonies françaises d’Afrique » au « franc des communautés financières d’Afrique ».
Le FCFA a été instauré par décret au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale sous le nom de « franc des colonies françaises d’Afrique ». La décision est alors motivée par la différence d’évolution de l’inflation durant la Seconde Guerre Mondiale qui ne permets plus de maintenir une parité d’un pour un entre les francs imprimés dans les colonies et ceux imprimés en métropole. Ainsi, à sa création 1 FCFA valait 1,7 franc français (FF).
Des critiques avant tout symboliques
Depuis son maintien dans les États nouvellement indépendants en 1960, le FCFA fait l’objet de nombreuses critiques. Ses détracteurs y voient un symbole de la Françafrique, la présence perpétuée de la France dans ses ancienens colonies. L’acronyme inchangé du « CFA » ainsi que la production de billets maintenue en France participe à la diffusion de ce sentiment. En réalité, la délocalisation partielle ou totale de la production de billets est une pratique courante, bien que difficilement mesurables. La moitié des 171 autorités monétaires dans le monde délocalisent au moins en partie leur production de billets et en Afrique seuls 8 pays sur 54 produisent leur monnaie localement. Ainsi des devises telles que le riyal qatari, le birr Ethiopien ou encore le denar macédonien sont toutes imprimés par l’entreprise britannique De La Rue, leader du marché. Par conséquent, la polémique qui entoure le FCFA semble davantage lié à une médiatisation excessive de sa situation qu’à une réelle anomalie.
Le choix de délocaliser la production de monnaie plutôt que de la maintenir localement est généralement motivé par les coûts élevés associés à cette dernière option, résultant des technologies de pointe utilisées et de leur évolution constante pour contrer la contrefaçon. Bien sûr, ce choix comporte des risques, mais ceux-ci sont partagés par toutes les banques centrales et doivent être distingués des critiques dirigées contre le FCFA. De plus, en tant qu’union monétaire, le FCFA est moins exposé aux risques de représailles ciblées. Ainsi, les récents coups d’État en Afrique de l’Ouest, bien que défavorables à Paris, n’ont apparemment pas entraîné de manipulation du FCFA.
Les réalités du débat économique
Ces débats symboliques occultent souvent le débat économique plus profond que pose la question du FCFA sur sa parité fixe avec l’euro, garantie par le Trésor Français. Celle-ci offre une stabilité remarquable à la monnaie, mais elle l’attache également à une devise forte qui peut mener à une surévaluation du FCFA et donc nuire à sa compétitivité.
Le choix d’un taux de change fixe par rapport au dollar ou à l’euro est une décision fréquente dans les pays en développement. Cette option présente l’avantage de réduire les risques liés aux fluctuations des taux de change, ce qui favorise l’attraction des investissements étrangers. Pour les pays de la zone franc, cette stabilité est renforcée par la garantie offerte par le Trésor français, constituant ainsi l’avantage majeur du FCFA. Opter pour un taux de change fixe implique généralement une gestion constante du marché des devises étrangères, avec un risque associé d’inflation. La garantie fournie permet aux pays de la zone franc de se prémunir de ces pratiques et de bénéficier des avantages d’une parité fixe sans en subir les inconvénients. Cette situation exceptionnelle en fait une monnaie refuge dans les pays de la région.
Le véritable questionnement réside dans le choix de l’euro comme devise de référence pour maintenir cette stabilité. L’euro, en tant que monnaie forte, pourrait rendre le FCFA moins compétitif en cas d’appréciation, impactant négativement les exportations des pays de la zone. Si l’ancrage au FF après la colonisation semblait logique en raison de la prépondérance commerciale de la France dans ces régions, cette justification perd de sa pertinence aujourd’hui, étant donné que ni la France ni d’autres pays européens ne sont les principaux partenaires commerciaux de ces pays aujourd’hui. Néanmoins, aucune alternative logique ne se profile pour le moment. Les États-Unis ne jouissent pas d’une présence suffisante dans les échanges avec ces pays pour envisager un ancrage au dollar, tandis que d’autres options telles que le renminbi chinois restent trop volatiles et peu utilisées dans les échanges internationaux pour être sérieusement considérées.