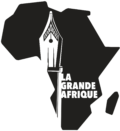Des villageois vaquent à leurs occupations dans un marché inondé à Kisumu, à environ 400 kilomètres à l’ouest de la capitale Nairobi, au Kenya. © EPA/Jacob Wire
Le Jour Zéro est arrivé. Enfin, presque.
Le 12 avril 2018, La ville du Cap a bien failli connaître le redouté “Day Zero”, soit le jour où l’eau ne coulerait plus dans les robinets de la plupart des particuliers. Décision envisagée par les autorités municipales suite à trois années de sécheresse ravageuses. In extremis, celles-ci sont parvenues à assurer l’approvisionnement en eau à cette date, évitant ainsi au Cap de devenir “la première grande ville moderne du monde à complètement manquer d’eau”. Loin d’être isolé, cet épisode n’est qu’une introduction au dilemme existentiel de l’eau en Afrique. Ce dernier met au défi l’ensemble du continent sous de multiples formes, allant du manque d’eau à la submersion, en passant par la pollution de l’or bleu. Cet article, le premier d’une série de deux consacrés à la pressante énigme de l’eau en Afrique, explore ces trois facettes du problème, exemplifiant chacune d’entre elles au travers d’une région particulière.
Sécheresse : le mirage de l’or bleu en Afrique du Nord
Comme le disait en 1732 le prénommé Thomas Fuller, un esclave afro-américain génie en mathématiques, “nous ne saisissons pas la valeur de l’eau tant que le puits ne s’est pas asséché”. La pluie exceptionnelle qui traverse dernièrement le nord du Sahara ne doit pas nous faire oublier qu’il s’agit bien d’un épisode rarissime dans l’une des régions les plus sèches du monde. Prenons le cas du Maroc, un royaume en stress hydrique qui l’an dernier a essuyé “une baisse des précipitations de 67% […] par rapport à une année jugée normale”, frappant de plein fouet le secteur agricole, premier contributeur au PIB et source d’emploi pour “un tiers de la population en âge de travailler”. Plus largement au Maghreb, les statistiques affolent, résultat d’un “changement climatique particulièrement accéléré dans le bassin Méditerranéen”. Les taux de remplissage des barrages en Algérie ne rassurent pas non plus, à l’instar de celui de Koudiat Asserdoun qui a affiché un taux de remplissage effarant de 3% début 2023. La même année, Tunis a dû “importer la totalité de ses besoins en céréales” après quatre années de sécheresse anéantissant les récoltes agricoles tunisiennes. Le manque d’eau est un fléau qui menace à présent la sécurité alimentaire au Maghreb mais aussi ailleurs. Les cycles de sécheresses qui sévissent sont notamment la source de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs de bétail en Afrique subsaharienne.
Pollution : l’Afrique de l’Ouest avance en eaux troubles.
La pollution de l’eau constitue un autre enjeu d’envergure, et l’Afrique de l’Ouest en est un exemple évocateur. Le Ghana, premier producteur d’or du continent, dispose d’une abondance d’eau enviable, notamment avec son lac Volta, le plus grand lac artificiel au monde. Pourtant Accra fait face à un fléau national qui empoisonne son or bleu. Il s’agit du Galamsey, nom donné par les Ghanéens à l’exploitation minière illégale. Pour réaliser l’ampleur des dégâts, la Ghana Water Company a annoncé que “60% des cours d’eau et réserves sont tellement pollués qu’ils ne peuvent plus être traités“ et le Galamsey est tenu pour responsable. D’un côté, ce secteur génère près de la moitié (43%) de la production totale d’or du pays et des millions de Ghanéens en dépendent comme source de revenu. Mais de l’autre, le reste de la société s’insurge de la pollution résultante de l’eau et nombre de pêcheurs ont vu leurs stocks de poisson s’effondrer à mesure que “la vague de l’exploitation minière illégale” continue de prendre “une dimension terrifiante”, avec des dégâts environnementaux “sans précédent”. En réponse, dans ce pays très attaché à la religion, une “marche de prière pour l’environnement” a été menée ce 11 octobre 2024 par l’archidiocèse d’Accra, mobilisant des milliers de citoyens ainsi que plusieurs organisations civiques. Un événement qui survient une semaine après l’appel à trois jours de manifestations lancé par une coalition d’associations contre la même bête noire. Des démonstrations populaires qui se déroulent en pleine période électorale, occasion prisée par les candidats à la présidence qui promettent la fin d’un fléau qui ne cesse de malmener les gouvernements successifs.
Le cas du Ghana est emblématique mais il n’est pas isolé dans la région, comme en témoigne le cas saisissant du Nigéria. Première puissance économique et démographique du continent, le pays dispose de réserves de pétrole colossales, faisant ainsi de l’or noir le principal contributeur à son PIB. Toutefois, comme au Ghana, la fameuse malédiction des ressources fait son effet puisque les écosystèmes sont dévastés par les rejets pétroliers. Le constat est sans appel : “Après avoir été l’espoir de tout un peuple dans les années 50, le pétrole est devenu, un demi-siècle plus tard, le pire de ses cauchemars, engendrant corruption, enlèvements, guerre civile. Dans le delta du Niger, l’or noir a réveillé les plus féroces appétits et engendré la plus grosse marée noire de tous les temps”.
Inondations : la goutte de trop en Afrique de l’Est
Du Soudan au Burundi, en passant par le Kenya, la RDC et la Somalie, c’est toute une région qui vit désormais au rythme des inondations. En 2018, la montée des eaux a affecté 1,5 million d’Est-Africains. L’année suivante, ce chiffre est monté à 4 millions, avant de grimper à 6 millions en 2020. A cette période, Khartoum la capitale du Soudan, ayant pour particularité d’être le point de rencontre du Nil Bleu et du Nil Blanc, a vu ce fleuve emblématique atteindre jusqu’à 17,57 mètres de hauteur, “son plus haut niveau depuis que les mesures ont commencé, il y a plus d’un siècle”. 100 personnes ont péri tandis que des quartiers entiers ont été submergés par des eaux déchaînées.
Plus récemment, le phénomène climatique El Nino est avancé pour expliquer la série impressionnante d’inondations d’un pays à l’autre en Afrique de l’Est, dont voici certaines illustrations. En décembre 2023, les pluies diluviennes qui se sont abattues au nord de la Tanzanie ont été si puissantes qu’elles ont provoqué un glissement de terrain considérable, emportant au moins 63 personnes sur leur passage. Plus tôt la même année, la Somalie a connu des déplacements de population dans des proportions spectaculaires, avec 408 000 déplacés pour cause d’inondations auxquels s’ajoutent étonnement 312 000 en raison de la sécheresse. Il y a quelques semaines, le Soudan du Sud a dû se confronter aux “pires inondations qu’il ait jamais connues depuis des dizaines d’années”. Plus de 40 comtés du pays sont sous l’eau, affectant au moins 1,4 million de personnes. Le plus jeune pays au monde est aussi l’un des plus pauvres et les rivalités autour du pouvoir n’arrangent rien pour aider les Sud-Soudanais à faire face à cette montée des eaux incontrôlable. Ces exemples ne sont qu’une poignée dans la vague d’épisodes recensés dans la région ces dernières années.