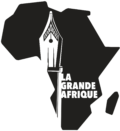Manifestation de défenseurs des droits de l’Homme et de victimes de l’épidémie de choléra, 15 octobre 2015 à Port-au-Prince. © AFP/HECTOR RETAMAL
Il est trop fréquent d’entendre des commentaires méprisants sur la situation actuelle d’Haïti, des jugements hâtifs qui dépeignent ses habitants comme responsables uniques de leurs difficultés ou encore comme des “cons”. Cette rhétorique omet souvent de reconnaître l’impact des actions extérieures sur l’histoire et le présent du pays. Aujourd’hui, concentrons-nous sur un épisode qui a bouleversé Haïti : l’introduction du choléra par une mission de l’ONU en 2010, un événement tragique pour lequel les réparations se font toujours attendre.
Une recherche biaisée au service du déni
Le 12 janvier 2010, Haïti était frappé par un séisme dévastateur qui tua des centaines de milliers de personnes et laissa une part importante du pays en ruines. Alors que la communauté internationale se mobilisait pour fournir de l’aide, des troupes de maintien de la paix de l’ONU, en provenance du Népal, furent déployées dans le cadre de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH).
L’épidémie de choléra en Haïti a officiellement débuté en octobre 2010. Les premiers cas sont apparus près de la rivière Artibonite, rapidement identifiée comme l’épicentre de la contamination. Très vite, des soupçons de la population se sont tournés vers le contingent népalais de la MINUSTAH, stationné non loin de cette rivière. Les habitants ont accusé les casques bleus d’avoir introduit la maladie via des déversements d’eaux usées dans les cours d’eau, mais l’ONU a nié en bloc toute responsabilité. Dans les médias internationaux, ces accusations ont souvent été décrites comme des théories du complot, sans fondement scientifique. Les sceptiques ont présenté ces allégations comme des tentatives de désigner un bouc émissaire face à une crise sanitaire imprévue.
Une chercheuse américaine, Rita Colwell, une des figures centrales dans la controverse sur l’origine du choléra en Haïti, avait soutenu que l’épidémie n’était pas liée aux forces de l’ONU. Pionnière en microbiologie et experte sur le choléra, elle a avancé que l’épidémie était d’origine environnementale, notamment en raison de la prolifération de bactéries dans des eaux stagnantes après le séisme de 2010. Cependant, son hypothèse s’appuyait sur des données qui ont ensuite été remises en question par d’autres scientifiques. Les analyses génétiques effectuées par des équipes indépendantes, notamment celles dirigées par Renaud Piarroux, ont invalidé ces arguments. Elles ont montré que la souche de choléra en Haïti était génétiquement identique à celle trouvée au Népal. Cette preuve scientifique a établi un lien direct entre l’introduction de la bactérie et les troupes de l’ONU, réfutant les affirmations initiales de Colwell.
Un déni des responsabilité malgré le bilan humain et social accablant
En quelques mois, le choléra s’est répandu comme une traînée de poudre, dans un pays déjà fragilisé par la catastrophe naturelle. L’épidémie a infecté plus de 820 000 personnes et causé la mort de plus de 10 000 Haïtiens. Elle a plongé des milliers de familles dans un cauchemar, exacerbant encore davantage la crise humanitaire.
Les infrastructures de santé défaillantes, les pénuries d’eau potable et l’absence de gestion efficace des déchets ont amplifié la catastrophe. Pourtant, les autorités internationales, conscientes de l’origine de l’épidémie, avaient tardé à reconnaître leur responsabilité. Pendant des années, l’ONU a refusé d’admettre son rôle dans cette tragédie, malgré des preuves scientifiques accablantes. Ce n’est qu’en 2016 que Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l’ONU, a exprimé des regrets. L’organisation a proposé un plan d’action pour éradiquer la maladie et améliorer les infrastructures d’assainissement, mais les fonds promis – 400 millions de dollars – n’ont été que faiblement levés, et aucune indemnisation directe n’a été accordée aux victimes ou à leurs familles.

« Au nom des Nations Unies, je tiens à dire très clairement : nous nous excusons auprès du peuple haïtien ». Le Secrétaire général Ban Ki-moon lors d’une réunion informelle de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la nouvelle approche de l’ONU pour lutter contre le choléra en Haïti. © ONU/Eskinder Debebe.
L’épidémie de choléra en Haïti ne se résume pas à des chiffres. Elle symbolise le mépris des puissances extérieures envers les vies haïtiennes, ainsi que l’absence de justice pour un peuple accablé par des crises qu’il n’a pas provoquées. Aujourd’hui encore, cette tragédie résonne comme un rappel brutal : les actions des puissances extérieures, qu’elles soient militaires, économiques ou sanitaires, peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le long terme. Reconnaître ces impacts est une condition essentielle pour construire un avenir plus juste pour Haïti et ses habitants.
Ne l’oublions pas.