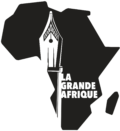La guerre qui ravage la République démocratique du Congo (RDC) depuis près de trois décennies ne se limite pas à un conflit lointain : elle est intimement liée à notre quotidien. Au cœur de cette tragédie se trouvent des ressources stratégiques dont le monde ne peut se passer. Le cuivre, le cobalt ou encore le coltan, omniprésents dans nos appareils électroniques et indispensables à la transition énergétique, ne sont que la partie émergée de l’iceberg.
En réalité, le sous-sol congolais regorge de ressources stratégiques : lithium pour les batteries, or et diamants pour le marché mondial, tungstène et cassitérite pour l’industrie technologique, zinc et manganèse pour la construction, sans oublier l’uranium aux enjeux nucléaires. Pourtant, ces richesses, loin de garantir le développement du pays, attisent convoitises et violences, alimentant l’un des conflits les plus meurtriers de notre époque.
L’Est de la RDC est le théâtre d’une guerre d’une rare intensité, où s’entremêlent massacres, pillages et déplacements massifs de populations. En octobre 2023, plus de 7 millions de personnes ont été contraintes de fuir, selon l’ONU. Derrière cette violence se cache une lutte acharnée pour le contrôle des mines et des routes commerciales. Parmi les groupes armés qui se disputent ces ressources, le M23 s’impose comme un des principaux acteurs du conflit au palmarès marqué par des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et certaines des pires exactions perpétrées contre les populations civiles. Depuis la reprise des combats en 2021, le groupe rebelle s’est emparé de plusieurs localités stratégiques (Goma, Bukavu, …), renforçant son emprise sur des territoires où se concentrent certains des minerais stratégiques et qu’il y a de plus précieux dans le pays. Mais son ambition dépasse désormais les frontières de l’Est congolais : comme l’a déclaré Corneille Naanga, coordonnateur de l’Alliance Fleuve Congo (AFC, coalition politique et militaire incluant le M23), le groupe entend « continuer la marche de libération jusqu’à Kinshasa« , faisant peser une menace directe sur la stabilité de la RDC.
Tandis que des milliers de Congolaises et Congolais sont chassés de leurs terres et massacrés, la communauté internationale demeure largement silencieuse. Pourquoi ce conflit, malgré son ampleur et ses ramifications économiques globales, reste-t-il relégué au second plan ? Pour en saisir toute la complexité, il est essentiel de revenir à ses origines

Guerre en RDC : les origines des guerres congolaises de fin de siècle
S’enlisant depuis un certain nombre d’années, la situation en RDC prend racine 30 années plus tôt, dans des rivalités ethniques. En effet, les provinces du Nord et du Sud-Kivu comptent un certain nombre de locuteurs autochtones (Hunde, Nande, Nyanga) et allochtones (Hutu et Tutsi). À cette époque, associées à des questions foncières, les oppositions se font particulièrement ressentir et donnent lieu à des massacres interethniques entre 1993 et 1994 au Masisi (territoire situé dans la partie Ouest du Kivu).
Le contexte du génocide rwandais qui a lieu en 1994 exacerbe cette situation. En effet, les massacres perpétrés contre la population Tutsi au Rwanda entraînent une vague de réfugiés hutus fuyant vers le Zaïre (actuelle RDC), notamment dans la région du Kivu. Ce mouvement de population, mêlé à des tensions anciennes, alimente et complexifie les conflits ethniques dans la région. Les affrontements finissent par se militariser, opposant une coalition composée de Hutu du Kivu et de réfugiés Hutus, parfois soutenus par des milices locales, aux Tutsi congolais. Ce conflit prend alors une dimension régionale, englobant l’ensemble du Kivu, du nord au sud, et impliquant directement le Rwanda. Un certain nombre de milices armées se créent dans la région, à l’instar de l’AFDL (Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo-Zaïre). Ce groupe armé et des pays voisins, comme le Rwanda ou encore l’Ouganda, viennent en soutien de Laurent-Désiré Kabila dans sa reprise du pouvoir au Congo en 1997 (première Guerre du Congo, 1996-1997) face à Mobutu Sese Seko (président du Zaïre jusqu’en 1997). Zone de tensions, la région du Kivu, qui concentre un certain nombre de matières premières essentielles (cassitérite, coltan, et autres minerais), devient un lieu d’exploitation par les acteurs à l’avant-garde de la Guerre.
Les alliances s’inversent et la seconde Guerre du Congo débute en 1998 opposant le Rwanda, l’Ouganda ainsi que des milices armées aux forces armées congolaises (bénéficiant du soutien de l’Angola, du Zimbabwe et de la Namibie). La guerre prend fin avec une série de traités de paix (Sun City et Luanda) qui sont signés en 2002. Les hostilités étaient censées cesser et pourtant, à l’Est du pays, ce sont d’autres partitions qui se jouent, débouchant, en 2004, sur un conflit aux yeux du monde entier, la Guerre du Kivu.
2004-2009 : l’embrasement d’une région aux enjeux et acteurs divers
Le Kivu, un conflit au carrefour des intérêts
Depuis 2004, l’Est de la RDC est le théâtre d’une guerre où s’entremêlent luttes de pouvoir et exploitation des ressources, notamment la cassitérite.
Au cœur du conflit, le Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) de Laurent Nkunda, soutenu par le Rwanda, impose sa domination sur le Kivu. Face à lui, le Front Démocratique de Libération du Rwanda (FDLR), composé d’anciens réfugiés hutus, bénéficie de l’appui du gouvernement congolais et des Forces Armées de RDC (FARDC), elles-mêmes impliquées dans le pillage des mines. Selon l’ONG Global Witness, « la 85e brigade des Forces armées de RDC (FARDC) participe au pillage des mines au Nord-Kivu ».
S’ajoutent à cette instabilité les milices Maï-Maï, opposées aux Tutsi et à l’ingérence rwandaise, et les puissances étrangères. Le Rwanda et l’Ouganda exploitent activement les ressources du Kivu, tandis que le Zimbabwe, l’Angola et la Namibie soutiennent Kinshasa en échange de concessions minières.
Un conflit alimenté de l’extérieur
Les puissances occidentales et asiatiques, en alimentant le commerce des armes et en achetant des minerais issus de l’exploitation illégale, contribuent indirectement au financement des groupes armés.
Face à cette crise, l’ONU déploie en 1999 la MONUC, mission de maintien de la paix, dont l’inefficacité suscite de vives critiques. Certains observateurs accusent même l’organisation d’aggraver la situation : « L’ONU, non seulement sous-traite les guerres de l’Est de la République Démocratique du Congo en faveur des agresseurs, mais surtout aggrave et cherche à pérenniser celle-ci pour ses intérêts ».
Malgré les traités de paix, le Kivu reste une région en proie aux violences, où se jouent des enjeux économiques et géopolitiques dépassant largement les frontières congolaises
L’économie de guerre au cœur du conflit
En proie aux guerres depuis une décennie, la RDC sous Joseph Kabila tente en 2002 de stabiliser l’armée en intégrant des milices via des opérations de mixage et de brassage. Mais ces groupes, à l’image du CNDP ou des Maï-Maï, poursuivent avant tout des intérêts ethniques et économiques, rendant le contrôle gouvernemental difficile.
Au cœur du conflit, l’économie de guerre structure les alliances et les affrontements : toutes les forces en présence visent l’exploitation des ressources minières. Ces richesses financent les groupes armés tout en fragilisant l’État, empêchant le développement d’institutions solides. Comme le souligne Roland Pourtier, « l’économie minière s’articule étroitement avec la guerre et l’insécurité. Tous les acteurs du conflit participent au pillage des ressources, soit pour financer l’achat d’armes, soit pour des raisons d’enrichissement personnel ».
Entre 2005 et 2007, le CNDP de Laurent Nkunda renforce son emprise sur le Kivu, s’opposant violemment aux FARDC et aux FDLR. Fin 2008, la situation humanitaire devient dramatique : plus de 1,2 million de personnes déplacées vivent dans l’exode permanent. Face à l’enlisement du conflit, Kinshasa engage en 2008 des pourparlers de paix, aboutissant à l’accord de Goma et à l’arrestation de Nkunda en 2009, marquant le démantèlement officiel du CNDP.
Accord et traité de paix : quelles incidences dans la région ? (2012-2013)
Une paix illusoire et l’émergence du M23
Malgré les accords de paix de 2008 et 2009, la guerre à l’Est du Congo ne connaît pas de véritable fin. La mise en œuvre du traité de 2009 reste lettre morte, laissant place à une nouvelle rébellion : le M23, héritier du CNDP. Dirigé par le général Ntaganda et soutenu par le Rwanda, ce mouvement impose un règne de terreur au Nord-Kivu, multipliant répressions violentes, viols systématiques et exploitation illégale des ressources.
Toutefois, contrairement au CNDP, le M23 peine à rallier les autres communautés du Kivu. Son leadership tutsi du Nord-Kivu ne trouve pas d’écho chez les Banyamulenge du Sud-Kivu ou la communauté hutu, ce qui précipite son déclin. En 2013, sous les offensives des FARDC, le mouvement capitule et ses combattants sont envoyés en Ouganda.
Pourtant, malgré cet accord, la violence persiste. Les groupes armés, davantage préoccupés par le contrôle des ressources minières que par la protection des populations locales, continuent d’opérer en toute impunité, maintenant le Kivu dans l’instabilité.
Un échec du maintien de la paix au Kivu : quelles conséquences observables ?
En réalité, cette date du 23 mars 2009 ne constitue aucunement la fin de la Guerre. Au contraire, il y a une suite logique des principes d’économie de guerre entre les acteurs sur place (émergence de nouveaux groupes armés) qui perpétuent un accaparement incessant des ressources minières donnant notamment lieu à des affrontements entre groupes armés et donc des déplacements de populations en grand nombre. L’ONU alerte déjà sur le déplacement de près de 400 000 personnes depuis le début de l’année 2025 du fait des violences qui sont perpétrées dans l’Est du pays.
Au-delà de ces déplacements, ce sont notamment des crimes contre l’humanité qui sont dénoncés depuis plus de 15 ans envers des populations qui se retrouvent réprimées, contraintes de se déplacer. À cet effet, S. Rubuye Mer s’interroge, dans son article Femmes victimes des violences sexuelles dans les conflits armés en République Démocratique du Congo, sur la place du viol perpétré pendant les conflits armés envers des femmes victimes de violences sexuelles. Selon l’autrice, « environ 83,6 % des viols ont été commis par des groupes armés d’appartenance et de nationalité diverse (milice, rebelle et armées d’États voisins) tandis que 10,9 % sont le fait de l’armée régulière ».
Ces chiffres soulignent l’incapacité des forces armées nationales à assurer la protection des civils et mettent en lumière les limites de la MONUSCO (qui a succédé à la MONUC en 2010), dont l’action peine à freiner les exactions. Au regard des faits sur le terrain, l’écart entre les ressources investies par la communauté internationale – tant sur le plan humain que financier – et les résultats obtenus suscite inévitablement des interrogations.
En mars 2022, le M23 émerge de nouveau alors qu’un certain nombre de milices (FNL burundaises, ADF ougandaises, …) luttent activement pour le contrôle des villes, engendrant selon Médecins Sans Frontières, en mars 2023, « la fuite de 150 000 personnes ainsi qu’une multiplication des cas de maladies (rougeole et choléra) dans certains sites accueillant des déplacés ».
Vers une sortie de crise ?
Malgré les interventions internationales et les missions de maintien de la paix, la situation en RDC reste plus instable que jamais. L’ONU, dont l’action a été largement inefficace, incarne l’échec des médiations internationales.. Pendant ce temps, les combats se poursuivent, alimentés par des intérêts géopolitiques et économiques où l’exploitation des matières premières l’emporte trop souvent sur la quête de paix.
La prise de conscience tardive de certains États occidentaux a conduit à la suspension de leurs accords de financement avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23, tandis que les forces d’Afrique australe amorcent leur retrait du sol congolais. Dans ce contexte, l’annonce récente par l’Angola de négociations de paix directes entre Kinshasa et le M23 à partir du 18 mars marquait un tournant inédit. Jusqu’ici, la présidence congolaise refusait tout dialogue avec cette milice, qualifiée de “groupe terroriste”. Malheureusement, ces discussions ont été annulées à la dernière minute bien que les chefs d’États voisins ont réaffirmé leur volonté de parvenir à une sortie de crise au plus vite.
Alors, simple illusion ou véritable espoir ? L’issue des pourparlers entre les pays le dira. Mais en attendant, ce sont des millions de Congolaises et de Congolais qui continuent de payer le prix d’une guerre sans fin, suspendus à une paix qui, après trente ans de chaos, semble toujours hors de portée.
Sources
- Abemba Ngongo, J. & Kanku Luandanda C. & Abemba Mulinda L. (2022). Les guerres de l’Est de la République Démocratique du Congo de la MONUC a la MONUSCO : incohérences et ambiguïtés des interventions de l’ONU. Revue Africaine Interdisciplinaire, Juillet-Septembre, 339-354. https://www.cadhd-dr.org/_files/ugd/bc3611_049a471ddf9c46d391dcbacaa3b36911.pdf.
- Braeckman, C. (2022). À l’est du Congo, les racines d’un quart de siècle de violence. Politique étrangère, Hiver(4), 157-169. https://doi.org/10.3917/pe.224.0157.
- De Villers, G. (2005). La guerre dans les évolutions du Congo-Kinshasa. Afrique contemporaine, 215(3), 47-70. https://doi.org/10.3917/afco.215.0047.
- Jackson, S. (2001). « Nos richesses sont pillées ! » Économies de guerre et rumeurs de crime au Kivu (C. Médard, Trad.). Politique africaine, 84(4), 117-135. https://doi.org/10.3917/polaf.084.0117.
- Jacquemot, P. (2009). Ressources minérales, armes et violences dans les Kivus (Rdc). Hérodote, 134(3), 38-62. https://doi.org/10.3917/her.134.0380.
- Jeune Afrique. « Est de la RDC : pour le Rwanda, la douche froide des suspensions d’aides – Jeune Afrique.com ». Consulté le 16 mars 2025. https://www.jeuneafrique.com/1665411/economie-entreprises/est-de-la-rdc-pour-le-rwanda-la-douche-froide-des-suspensions-daides/.
- Le Monde. « Guerre en RDC : des « négociations de paix directes » entre Kinshasa et le M23 débuteront le 18 mars à Luanda ». 13 mars 2025. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/03/13/guerre-en-rdc-des-negociations-de-paix-directes-entre-kinshasa-et-le-m23-debuteront-le-18-mars-a-luanda_6580052_3212.html.
- Le Monde. « Guerre en RDC : les pays d’Afrique australe mettent fin à leur mission militaire ». 13 mars 2025. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/03/13/guerre-en-rdc-les-pays-d-afrique-australe-mettent-fin-a-leur-mission-militaire_6580316_3212.html.
- Le Monde. « Guerre en RDC : un « cessez-le-feu » humanitaire du M23 avant un sommet avec Tshisekedi et Kagame ». 4 février 2025. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/02/04/guerre-en-rdc-un-cessez-le-feu-humanitaire-du-m23-avant-un-sommet-avec-tshisekedi-et-kagame_6531119_3212.html.
- Médecins Sans Frontières. Nord-Kivu : Plus d’un million de personnes déplacées par les combats, des besoins immenses et non-couverts. (2023, mai 3). Médecins Sans Frontières (MSF). https://www.msf.ch/nos-actualites/articles/nord-kivu-plus-dun-million-personnes-deplacees-combats-besoins-immenses-non.
- Pourtier, R. (2009). Le Kivu dans la guerre : Acteurs et enjeux. EchoGéo. https://doi.org/10.4000/echogeo.10793.
- Pourtier, R. (2011). Chapitre 17—Les enjeux miniers de la guerre au Kivu. In Les conflits dans le monde (p. 235-248). Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.gibli.2011.01.0235.
- « RDC : près de 7 millions déplacés par les violences, la grande majorité a besoin d’aide | ONU Info », 30 octobre 2023. https://news.un.org/fr/story/2023/10/1140132.
- Ritimo. (2012, décembre 10). Nord-Kivu : Une guerre sans fin ? ritimo. https://www.ritimo.org/Nord-Kivu-une-guerre-sans-fin.
- Rubuye Mer, S., & Flicourt, N. (2015). Femmes victimes des violences sexuelles dans les conflits armés en République Démocratique du Congo. Sexologies, 24(3), 114-121. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2015.06.003.
- Stearns, J. (2013). Repenser la crise au Kivu : Mobilisation armée et logique du gouvernement de transition (R. Botiveau, Trad.). Politique africaine, 129(1), 23-48. https://doi.org/10.3917/polaf.129.0023.
- TV5MONDE – Informations. Présidentielle en RDC : Où en est le conflit dans l’est du pays ? (2023, novembre 19). https://information.tv5monde.com/afrique/presidentielle-en-rdc-ou-en-est-le-conflit-dans-lest-du-pays-2676381.
- ONU info. Les combats dans l’est de la RD Congo ont fait plus de 400.000 déplacés depuis le début de l’année. (2025, janvier 24). https://news.un.org/fr/story/2025/01/1152431.