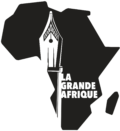« De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ? », un récent rapport de recherche en explore les causes déconstruisant le concept de sentiment anti-français. (Illustration du rapport par Axel Champloy, 2024).
“Je crois qu’on a oublié de nous dire merci”, a estimé le 6 janvier Emmanuel Macron lors de la conférence annuelle des ambassadrices et des ambassadeurs, à propos de l’opération Barkhane (2014-2022). Le président français persiste à croire que la France “avait raison” d’intervenir militairement au Sahel contre le terrorisme, et a fustigé l’“ingratitude” et le manque de “courage” de certains “gouvernants africains”.
S’ils visaient les dirigeants sahéliens arrivés au pouvoir après des putschs militaires, ces propos, par leur virulence, ont créé la polémique dans d’autres pays d’Afrique francophone. “Je crois qu’il se trompe d’époque”, a déclaré le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, après que son gouvernement a dénoncé une “attitude méprisante”. Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais, a de son côté rappelé que la France “a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité au Sahel.” Le Tchad et le Sénégal ont réaffirmé leur souveraineté dans leur décision, le 28 novembre dernier, d’acter le départ des militaires français présents dans des bases sur leur sol.
Ces réactions témoignent d’un écart, entre d’une part un supposé sentiment anti-français, une expression de plus en plus utilisée en France ces dernières années, et d’autre part des éléments de “contestation de la politique française en Afrique”, comme l’ont rectifié le journaliste Ousmane Ndiaye et d’autres intellectuels.
L’analyse a récemment été approfondie dans un rapport de recherche intitulé “De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom?”, publié par le mouvement citoyen Tournons la page (TLP) et le Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI). Chez les participants, militant.es et syndicalistes de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Gabon, l’expression a été rejetée “à l’unanimité” : “On n’a pas de problème anti-français. [Le problème] c’est la politique française chez nous.”, a ainsi corrigé l’un d’entre eux.
Au vécu des populations est opposée l’idée, côté français, d’une politique incomprise ou méconnue, ce qui n’est pas sans rappeler la situation à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Or le recours au “sentiment anti-français” par les responsables politiques est récurrent dès lors qu’une action menée par la France se trouve contestée sur le continent : “L’usage du terme « sentiment », renvoyant à l’affect en politique, tendrait à faire de la critique de la France une critique irrationnelle”. Le rapport aborde, les uns après les autres, les différents aspects de cette critique depuis les indépendances politiques des années 1960.
La présence des militaires français est ainsi jugée comme n’ayant pas permis d’améliorer la situation sécuritaire. Si le rapprochement de certains pays avec la Russie fait débat, il ressort des discussions que “la propagande russe se nourrit des errements de la politique africaine de la France, mais elle n’en est pas à l’origine”.
Sur le plan économique, il est difficile d’oublier la proximité entre certaines entreprises françaises et des régimes corrompus. C’est ce qui peut faire de plusieurs d’entre elles des symboles des intérêts français en Afrique, comme les magasins Auchan, pillés à plusieurs reprises au Sénégal. D’un point de vue diplomatique, la politique du “deux poids, deux mesures” est fustigée. Il est reproché à Emmanuel Macron d’avoir reconnu la réélection d’Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire pour un troisième mandat et la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby au Tchad après la mort de son père, tout en condamnant les coups d’Etat au Sahel. L’usage de la démocratie comme d’une façade est pointé comme étant l’un des facteurs de l’espoir populaire suscité par les coups d’Etat.
Le rapport reflète une sensation partagée de souveraineté inachevée, en particulier économiquement : ses conclusions ne sont pas nouvelles et suggèrent un effet d’accumulation, issu d’une certaine continuité coloniale. En 2022, Tournons la page préconisait, entre autres, de “Se départir de la posture considérant la France comme ayant une “vocation” africaine, condition de la “grandeur” du pays sur la scène internationale.”
Dans l’objectif de constituer un “préalable pour reconstruire une relation fondée sur le respect mutuel”, l’équipe de recherche reconnaît ses propres biais (“une équipe éditoriale principalement française, masculine et imposant le rythme et les objectifs depuis Paris”). L’ensemble des éléments historiques comme contemporains explorés dans les débats – tous n’ont pas pu être mentionnés – donne un aperçu du chemin qu’il reste à parcourir, tant dans la prise de conscience que dans les actes, sans oublier les paroles.