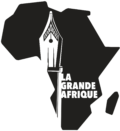Lorsque Cyril Ramaphosa abat son maillet en bois pour clore les débats, au Sandton Convention Centre, le soulagement est palpable. Le président sud-africain a tenu bon. Son sommet a eu lieu, sa déclaration finale a été adoptée, et l’honneur du continent est sauf. « Notre accord démontre la valeur du G20 », lance-t-il à la tribune, comme pour se convaincre, et convaincre le monde, que le multilatéralisme respire encore.
Pourtant, derrière les sourires de façade et la rhétorique de l’Ubuntu (« Je suis parce que nous sommes »), l’atmosphère qui régnait à Johannesburg n’était pas à l’euphorie, mais à la gravité lucide. Ce sommet restera dans les annales comme celui du grand paradoxe : jamais l’Afrique n’avait autant pesé sur l’agenda d’un G20, réussissant à inscrire ses priorités vitales dans le marbre d’une déclaration commune. Mais jamais l’outil G20 n’avait semblé aussi fragile, aussi impuissant, aussi menacé d’obsolescence. Comme l’a résumé froidement Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre présent sur place : « Nous ne vivons pas une transition, mais une rupture ».

Le G20 : un colosse aux pieds d'argile
Pour mesurer la portée de ce sommet, un rappel s’impose. Créé en 1999 pour stabiliser la finance mondiale après les crises asiatiques, le « Groupe des Vingt » est le principal forum de coopération économique internationale. Il rassemble les 19 plus grandes puissances de la planète, l’Union européenne et, depuis 2023, l’Union africaine. Ce club pèse lourd : il représente à lui seul 85 % du PIB mondial, 75 % du commerce international et deux tiers de la population du globe. Théoriquement, il constitue l’unique forum où les puissances rivales se concertent pour harmoniser leurs politiques. Toutefois, dépourvu de secrétariat permanent et de pouvoir coercitif, le G20 est tributaire du consensus. Une dynamique fragile que la défection américaine a, cette année, manqué de rompre.
Le coup de poker de Pretoria
Pour saisir la portée de ce qui s’est joué du 22 au 23 novembre, il faut d’abord analyser la méthode. L’Afrique du Sud savait qu’elle marchait sur un champ de mines. L’administration Trump avait officialisé son boycott total du sommet, justifiant cette rupture inédite par des désaccords commerciaux et idéologiques profonds avec Pretoria. Face à l’hostilité affichée de la première puissance mondiale, décidée à faire dérailler l’événement, l’échec semblait programmé.
C’est là que le génie tactique de la diplomatie sud-africaine a opéré. Dès le samedi matin, au premier jour du sommet, contre toute attente et rompant avec une tradition vieille de vingt ans qui veut que le communiqué soit le fruit de tractations jusqu’à la dernière minute, Cyril Ramaphosa a fait adopter la déclaration finale à l’ouverture des débats.
Ce n’était pas de l’impatience, mais de la survie. Pretoria a pris les saboteurs de vitesse. En verrouillant le texte avant que les dissensions ne s’enveniment, l’Afrique du Sud a appliqué une stratégie de contournement inédite. Selon William Gumede, professeur à l’université de Witwatersrand, cette manœuvre a permis « d’isoler et de construire un mur autour de Trump en intégrant l’Afrique et d’autres puissances émergentes ». L’objectif était clair : prouver que le monde ne s’arrête pas de tourner quand l’Amérique boude. Cette victoire procédurale est indéniable. Elle sauve la face. Mais elle agit aussi comme un révélateur cruel : un forum qui doit ruser avec ses propres règles pour accoucher d’un texte commun est un forum malade.
Le vide américain, boulevard pour l'Empire du Milieu
La nature a horreur du vide, la géopolitique plus encore. L’absence des États-Unis — justifiée par Donald Trump par la fable d’un « génocide blanc » en Afrique du Sud et par son mépris pour les concepts « DEI » (Diversité, Équité, Inclusion) — a radicalement modifié l’équilibre des forces dans la salle.
Ce boycott n’a pas seulement affaibli l’Occident, il a offert un boulevard à la Chine. Le contraste était saisissant. Pendant que Washington infligeait des tarifs douaniers punitifs de 30 % aux exportations sud-africaines, le Premier ministre chinois Li Qiang jouait à Johannesburg la carte du « zéro tarif » pour l’Afrique.
Dans une inversion spectaculaire des rôles historiques, c’est Pékin qui s’est posé en dernier défenseur du libre-échange et des institutions internationales face au protectionnisme américain. Li Qiang a habilement occupé l’espace, appelant à réformer la Banque Mondiale et le FMI pour donner plus de voix au Sud, un discours qui résonne doucement aux oreilles africaines. Dans ce G20 fragmenté, la ligne de fracture n’est plus seulement Nord-Sud ; elle se dessine désormais entre ceux qui jouent le jeu des institutions (Chine, Union Européenne, Union Africaine) et ceux qui semblent prêts à les dynamiter (États-Unis, Argentine).
L’agenda africain : des victoires de papier ?
Sur le fond, l’Afrique a-t-elle imposé son agenda ? Si l’on s’en tient au texte de la déclaration, la réponse est oui. Le document de 30 pages porte la marque indélébile des priorités continentales.
La victoire la plus significative concerne les minerais critiques. Le texte entérine le « G20 Critical Minerals Framework », qui reconnaît enfin la nécessité pour les pays producteurs de ne plus se contenter d’exporter de la roche brute. La mention explicite de la « transformation locale » (beneficiation at source) est une victoire idéologique majeure sur le modèle extractiviste qui appauvrit le continent depuis les indépendances.
Au-delà des symboles, le sommet a réussi à imposer des réalités concrètes. Le soutien à la « Mission 300 » pour l’électricité et l’accent mis sur la « cuisson propre » obligent enfin le G20 à s’intéresser aux besoins vitaux des populations, et plus seulement à la finance abstraite. Politiquement, l’appui à une Convention fiscale de l’ONU est tout aussi stratégique : il marque la volonté de briser le monopole de l’OCDE — le club des pays riches — pour décider enfin des règles fiscales mondiales de manière plus équitable.
Pourtant, ce succès diplomatique bute sur une réalité financière implacable. Sur la question vitale de la dette, l’Afrique n’a obtenu aucune révolution. Faute de consensus, le texte recycle le « Cadre Commun », un mécanisme dont la lenteur a déjà lourdement pénalisé des pays comme la Zambie ou l’Éthiopie. Sans outils contraignants pour forcer les créanciers à agir, ces belles promesses risquent de ne jamais se transformer en bouffée d’oxygène pour les économies africaines.
Surtout, l’absence des États-Unis vide de sa substance une grande partie des engagements financiers. La déclaration promet de « mobiliser des milliers de milliards » pour le climat et le développement. Mais qui signera les chèques ? Sans l’aval de la première économie mondiale et du principal actionnaire des institutions de Bretton Woods, ces promesses risquent de rester lettre morte. L’Afrique a écrit le menu, elle a dressé la table, mais le principal banquier n’est pas venu dîner.
« La fin d’un cycle » : le diagnostic existentiel
Au-delà des succès techniques sud-africains, ce sommet a laissé transparaître une angoisse existentielle sur l’avenir de la gouvernance mondiale. Emmanuel Macron, dans une sortie qui rappelle son diagnostic de « mort cérébrale » de l’OTAN, a lâché le mot juste : « Le G20 arrive peut-être à la fin d’un cycle ».
Conçu pour gérer les crises financières dans un monde globalisé, le forum semble aujourd’hui tétanisé par la fragmentation géopolitique. Il est incapable d’arrêter les guerres en Ukraine ou à Gaza, impuissant face à la montée des tensions commerciales, et divisé sur l’urgence climatique. « La nostalgie n’est pas une stratégie », a prévenu Mark Carney. Les appels à la « remobilisation » lancés par les Européens sonnaient comme des vœux pieux face au mur de l’unilatéralisme qui se dresse.
L’image la plus forte de ce sommet restera sans doute celle qui n’a pas existé. Dimanche, le protocole prévoyait la traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir entre le pays hôte et le futur président du G20. Mais Cyril Ramaphosa a refusé de transmettre le flambeau au représentant américain, un simple chargé d’affaires envoyé par Washington. Ce refus était un acte politique fondateur : l’Afrique, longtemps habituée à avaler des couleuvres diplomatiques, refuse désormais d’être traitée avec condescendance.
Mais la réplique de Washington ne s’est pas fait attendre, scellant le divorce. Mercredi, Donald Trump a franchi un nouveau palier dans l’offensive diplomatique en annonçant que l’Afrique du Sud ne serait pas invitée au prochain sommet du G20 à Miami en 2026. Reprenant ses accusations sur une prétendue persécution des fermiers blancs, le président américain a cinglé : « L’Afrique du Sud a montré au monde qu’elle n’était pas un pays digne d’être membre de quoi que ce soit ».
Cette exclusion inédite confirme les pires craintes des observateurs : le G20 de Johannesburg n’était pas seulement difficile, il était peut-être le dernier du genre. Avec une présidence américaine qui s’ouvre par une excommunication, l’avenir de l’agenda africain ne se jouera plus dans les salons feutrés du multilatéralisme, mais dans un monde de blocs rivaux où le dialogue est rompu.